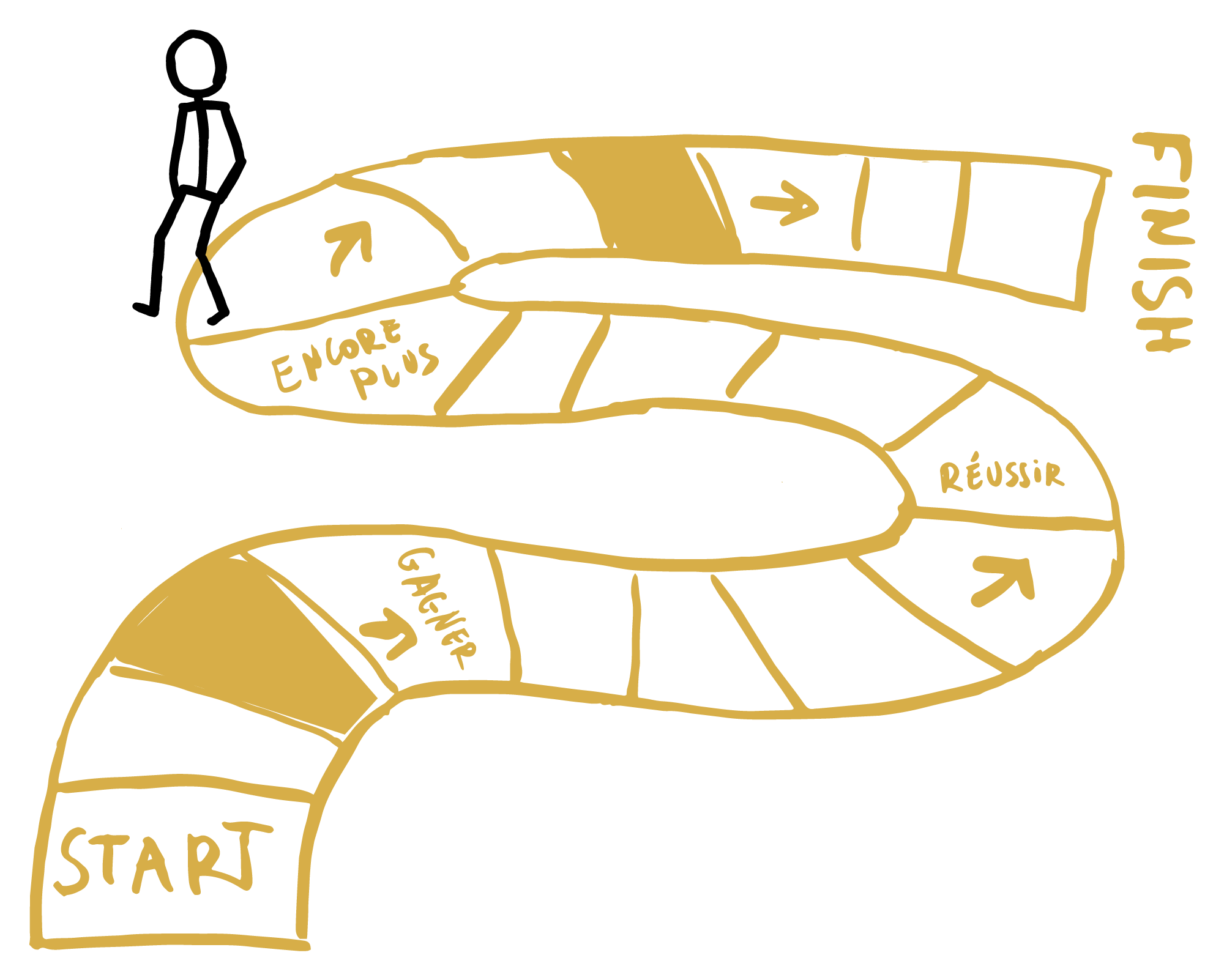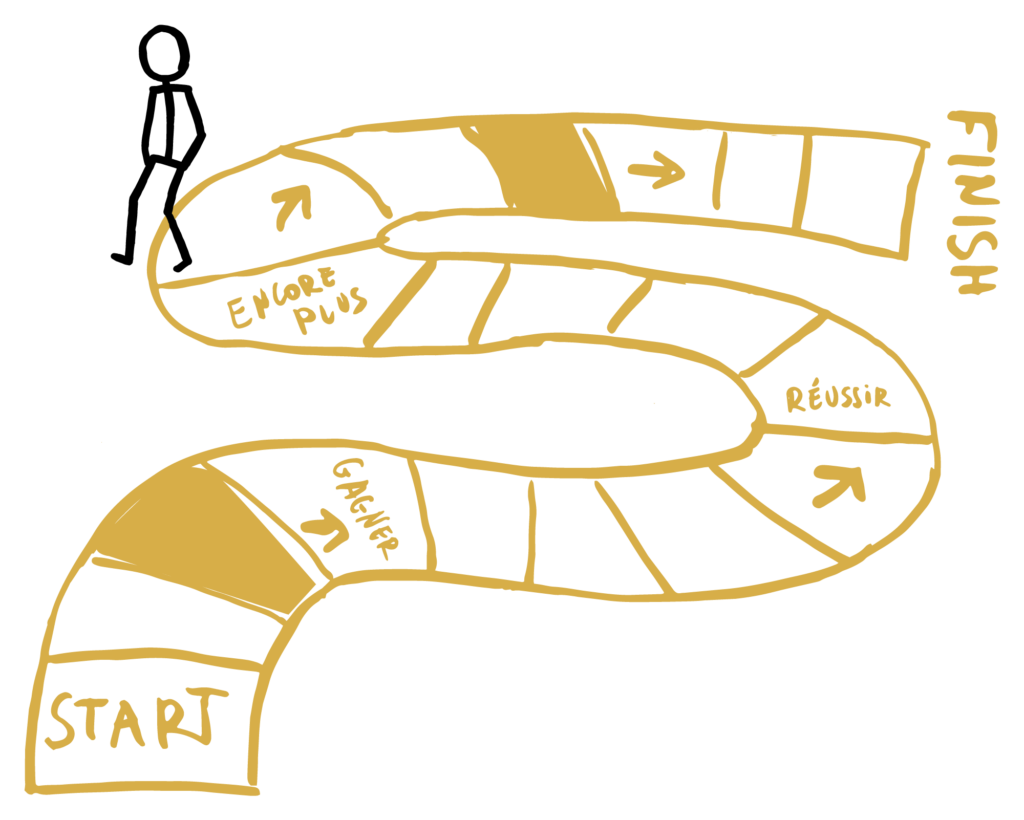
Le refus de parvenir contre le toujours plus de nos sociétés
Dans votre livre Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, vous revenez longuement sur la notion du « refus de parvenir », comme la définissez-vous ?
Le refus de parvenir va bien au-delà de l’aspect matériel, même s’il l’inclut. Il s’agit du refus des privilèges, des distinctions et promotions individuelles, ou de la « réussite » telle que l’accumulation matérielle, présentée et érigée en modèle la définit, c’est-à-dire de manière extrêmement réductrice et basée sur l’accumulation du superflu.
Or, l’écologie me semble très liée d’une part à la question des inégalités sociales, et d’autre part à un important sentiment de frustration sociale. En effet, quand un modèle exposé dans les médias, par la publicité, la mode donne à voir à des gens qui se débattent dans la précarité, que le nec plus ultra serait justement d’accumuler du superflu, il y a de quoi comprendre l’émergence de la colère et du sentiment d’injustice. Cette indécence sociale a aussi des impacts environnementaux. La mondialisation, les rouages du capitalisme et cette société de consommation sont à l’origine d’une grande partie de la dégradation de l’état de la biosphère. À la fois par le prélèvement sur les ressources naturelles, la pollution générée par des transports de marchandises absurdes et infinis, et les émissions de gaz à effet de serre générées. On peut pourtant tenter de s’en extraire, chacun à sa manière et selon ses possibilités, en faisant un pas de côté.
Refuser de parvenir, c’est aussi chercher à sortir du rythme imposé. Car nous baignons dans une culture de l’instantané, de la précipitation, de l’immédiateté qui n’est pas toujours bonne conseillère. J’aime l’idée du ralentissement ou en tout cas, de manière plus juste, de la réappropriation du temps. Bien sûr, nous pouvons choisir parfois d’aller vite sur certains sujets, ou de « réussir » au sens des conventions sociales. L’ambition, la vitesse ne sont pas forcément mauvaises en soi, à condition qu’elles soient le résultat d’un choix singulier et d’une véritable délibération. On pourrait dire la même chose de la réappropriation de nos corps dans cette société et de bien d’autres choses encore. J’ai essayé d’exprimer dans mon livre que ce refus de parvenir, ces petits pas de côté que chacun peut trouver à son échelle, en fonction de ses conditions matérielles, de ses marges de manœuvre, sont l’occasion de reprendre un peu de souveraineté, de libre arbitre et d’autonomie pour soi-même…
La question de savoir si on avait le droit de parler de refus de parvenir alors que tant de personnes manquent de ce qui est nécessaire à une vie décente m’a beaucoup agitée. Je suis bien consciente que tout le monde n’a pas les mêmes possibilités. Mais précisément, pour que les plus précaires puissent se réapproprier aussi cette part de souveraineté individuelle qu’incluent la capacité et la possibilité de refuser le superflu, il faut que les plus nantis se dépouillent. Ou soient dépouillés.
Comment est-ce qu’on s’autorise et comment est-ce qu’on actionne ces transgressions, ces pas de côté ?
En sortant de cette manière de ne voir en nous que des producteurs-consommateurs permanents. Ce refus, c’est un premier pas vers le fait de se réapproprier sa dimension d’individu libre. Finalement le plus important n’est pas tant le résultat du refus que le refus lui-même. Quelle que soit son ampleur, poser ce refus c’est déjà commencer à faire des pas de côté. C’est déjà contribuer, comme je l’écris dans mon livre, à mettre « un coup d’opinel dans la toile des conventions ». Une fois que l’on a effectué un premier pas de côté, chaque pas suivant devient plus facile. Il y a parfois même une vraie jubilation à se singulariser et ne pas accepter tout ce qui vient sous forme d’injonction sociale. Ces petits choix individuels ne sont certes pas des actes susceptibles de renverser le système ni de sauver la planète. Pour autant, ils restent importants dans une société tellement homogène et standardisée. On a tellement mis nos désirs dans des cases que finalement c’est aussi dans ces interstices de liberté que le subversif renait. Je pense que ces refus ont une portée politique, tant ils vont à contre-courant de tout ce qu’on nous dicte.
Vous souhaitez réhabiliter la « beautiful loose », de quoi s’agit-il ?
Je fais allusion à tous ces antihéros, ces perdants magnifiques qui sont des personnages rarement mis en avant dans une société de la compétition et du mérite, où il faut que les choses soient polémiques ou « bling-bling » pour attirer l’attention et exister. A côté de cela, il existe toute une série de personnages, réels ou fictifs, un peu losers, n’ayant pas eu de grandes carrières ou de grands moments de gloire, mais qui ont pour autant vécu des vies hors norme, avec une forme de panache. Je pense au mouvement punk également, qui a produit de belles aventures, avec des parcours parfois très fulgurants, parfois aussi, il faut le dire, d’une grande tristesse, mais avec toujours une forme de voracité pour l’existence, cette manière de cramer la vie sans compter. Les Cyranos, les dandys de caniveau, j’aimerais qu’on apprenne à ne pas y voir que de la déchéance, mais aussi une forme d’élégance et de beauté.
Dans votre livre, vous reprenez le slogan : « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes, la nature qui se défend », qu’évoque-t-il pour vous ?
Je trouve ce slogan scandé un peu partout et qu’on a notamment entendu à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vraiment admirable, car il contient en une phrase beaucoup de choses extrêmement importantes, à commencer par le « nous » du collectif et de la lutte. Mais aussi la critique de l’anthropocentrisme qui nous a en grande partie menés à la situation inextricable dans laquelle nous sommes aujourd’hui englués. Si on y songe deux secondes, ce sentiment de toute-puissance de l’espèce humaine puéril, si ce n’est criminel, est totalement délirant. On ne pourra pas faire l’économie de remettre l’être humain à sa place : au sein des écosystèmes, dans un lien, non pas d’égalité, mais d’interdépendance. On commence seulement aujourd’hui à prendre conscience que notre survie dépend de celle des écosystèmes et de l’ensemble du vivant. Il y a donc d’une part une nécessité à repenser notre place dans ces écosystèmes, et d’autre part une urgence à arrêter de les massacrer.
Ensuite, il y a la question du monde dans lequel on veut vivre. Avons-nous envie de vivre dans un monde entièrement artificiel et bétonné où nous ne serions plus jamais en contact avec l’humus, le végétal, l’animal et où il n’y aurait plus de saisons ? Je crois vraiment que cette question de l’exposition au sauvage, à la beauté des paysages, reste aujourd’hui éminemment politique. Je cite dans mon livre deux auteurs qui ont travaillé sur ce sujet, William Morris et Élisée Reclus, qui font magnifiquement le lien entre cette exposition à la beauté et la capacité à ne pas se soumettre, à lutter contre ce qui asservit. Je pense que cela fait partie des choses qui aident à redresser la tête et à ne pas abandonner.
Vous mettez en opposition les Modernes (et leur aveuglement du progrès à tout prix) par rapport aux « Terrestres » qu’a décrits Bruno Latour, que voulez-vous dire par là ?
L’idée est justement de questionner la modernité qui instaure et accompagne ce sentiment de toute-puissance de l’espèce humaine. Cette illusion de pouvoir se déconnecter totalement de ce qui nous entoure et du reste du vivant. Il s’agit de dépasser le dualisme nature / culture, comme l’a écrit Philippe Descola, et de nouer des complicités entre l’être humain et le reste du vivant, de retrouver notre condition de terrestre et d’habitant de cette planète, de nos territoires. Bruno Latour invite à y réfléchir notamment en termes de subsistance : habiter un territoire c’est aussi en tirer sa subsistance. C’est une réflexion intéressante, car elle interroge aussi la question de la mondialisation, de la délocalisation et de la perte d’autonomie dans nos sociétés modernes. Interrogeons nos besoins de base, qu’il s’agisse de se nourrir, de se chauffer, de s’habiller, de se déplacer ou de communiquer. Quelle que soit l’idée qu’on se fait de la perspective d’effondrement, on sait en tout cas qu’avec l’urgence climatique et la déplétion des ressources naturelles on ne va pas pouvoir continuer à recourir aux énergies fossiles comme on l’a fait jusqu’ici. Soit qu’elles viendront à manquer, soit que leur extraction et leur utilisation génèreront une telle augmentation des températures que plus personne ne sera là pour le voir…
Notre société est tellement dépendante aujourd’hui du pétrole, de l’électricité, des technologies numériques… Se pose vraiment cette question de retrouver de l’autonomie, et cela appelle un petit effort d’imagination. J’aime bien poser cette question dans mes interventions : à quoi ressemblerait une société sans pétrole, sans État ou sans électricité par exemple ? Je ne sais pas si on en arrivera là, mais cet exercice d’imagination politique me parait loin d’être inutile.
Face aux théories de l’effondrement civilisationnel et la perspective du chaos, vous parlez d’éthique de l’effondrement. Quel nouvel imaginaire politique pourrait émerger face au vertige collaposlogique ?
J’observe une effervescence assez importante depuis plusieurs mois autour de cette notion d’effondrement. Je vois arriver dans les débats et les conférences beaucoup de personnes, de jeunes notamment, qui ont lu les tenants de ce courant et qui d’une certaine manière découvrent la collapsologie avant de découvrir l’écologie politique. Dès lors, ils manquent de munitions politiques qui leur permettraient de transformer des émotions individuelles en organisation et en lutte collectives. Cela demande en effet un peu de culture politique et d’avoir une colonne vertébrale idéologique, ce que la collapsologie n’apporte pas forcément. Je suis reconnaissante envers ces auteurs, car ils ont provoqué une véritable accélération dans la prise de conscience. Maintenant, le chantier, c’est donc bien celui de politiser la collapsologie c’est-à-dire de transformer cet élan en engagement collectif.
Ensuite, une critique est souvent faite sur la notion d’effondrement : si tout doit s’effondrer, à quoi bon continuer à faire attention ou à mener des combats ? N’est-ce pas là une incitation à baisser les bras ? Toujours est-il que, effondrement à venir ou pas, la situation aujourd’hui est déjà extrêmement préoccupante. Les dégâts sociaux et environnementaux sont bien présents et touchent déjà les populations les plus précaires, notamment dans les pays du Sud. Il y a plus que jamais des combats politiques à mener ! Revenons sur la question du dérèglement climatique : il est aujourd’hui à peu près admis que le dépassement du seuil de + 1,5 degré est déjà inscrit dans les émissions de gaz à effet de serre émises jusqu’ici. Nous serons probablement condamnés à franchir les + 2 degrés d’ici 2040, et beaucoup plus d’ici la fin du siècle. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille plus rien faire pour le climat, bien au contraire : chaque dixième de degré supplémentaire compte ! Il y a toujours plus de précaires à qui témoigner de la solidarité, d’espèces d’invertébrés à protéger, d’hectares de terres agricoles à empêcher d’être bétonnés. Le combat politique et militant ne doit pas s’arrêter. Et c’est là que peut intervenir la question de la « dignité du présent » que je développe dans le livre. Alors que les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, face à un monde qui semble sombrer sur beaucoup d’aspects, y compris d’un point de vue culturel, il est important de se souvenir que le moteur de l’engagement n’est pas uniquement une question de gains futurs, de victoires à venir. Il y a au contraire beaucoup de combats que l’on mène, non parce qu’on est assuré de pouvoir les gagner, mais simplement parce qu’ils sont justes, sans en attendre de rétribution, simplement pour la beauté, l’élégance du geste. Pour pouvoir se regarder dans la glace, comme on dit. Je pense que c’est important de le rappeler aujourd’hui, car nous sommes nombreux·ses à traverser des phases de découragement. Il faut garder à l’esprit ce ressort de la dignité du présent, c’est un moteur non négligeable.
Alors que certains estiment que l’écologie n’est ni de droite ni de gauche, en quoi la lutte contre la destruction des écosystèmes et les changements climatiques peut s’avérer au contraire une manière de réactiver une lutte des classes ?
En ce moment, on entend une petite musique qui laisse croire que l’urgence écologique doit gommer les clivages, que cette question n’est ni de gauche ni de droite et qu’il devrait y avoir une grande union sacrée face au péril. Comme si tout d’un coup, l’urgence écologique allait gommer les rapports de force et de domination qui existaient jusqu’ici dans la société. Je pense que ce positionnement est illusoire.
D’abord, parce qu’il y a de fait une responsabilité différenciée selon les pays, les individus et les classes sociales. C’est largement documenté, nous pouvons aujourd’hui établir avec certitude que ce sont les pays les plus riches et les plus industrialisés, qui ont le plus émis de gaz à effet de serre. On sait également que ce sont les individus les plus riches qui ont les modes de vie les plus polluants et destructeurs du vivant.
Ensuite, les conséquences ne sont pas non plus vécues de la même manière par tous. Aujourd’hui, les premières victimes de l’intensification, de la multiplication d’un certain nombre d’aléas climatiques extrêmes sont les plus précaires. Ce sont les petits pêcheurs traditionnels des pays du Sud ou les paysans qui n’ont pas les ressources pour faire face à des épisodes de sècheresse ou à des inondations qui s’accumulent. Dans nos pays, les habitants des quartiers populaires sont aussi les plus exposés à la pollution : c’est dans leurs zones d’habitat que s’implantent les industries chimiques les plus toxiques, les axes routiers les plus polluants. On commence à ce sujet à entendre parler d’apartheid environnemental.
Enfin, les stratégies de mise à l’abri ne sont pas les mêmes. Il existe une classe de gens extrêmement riches qui peuvent mettre en place des stratégies d’évitement et de protection. Ce sont les milliardaires de la Silicon Valley qui se construisent des bunkers ou s’achètent des îles dans lesquelles ils font stocker des armes, des munitions, des denrées alimentaires, de l’eau potable. Ou se payent des agences chargées de les exfiltrer en cas de conflit, de début de guerre civile, d’inondation ou d’ouragan… Donc non, nous ne sommes pas tous égaux face à la multiplication de ces risques.
Aujourd’hui, certains intérêts, notamment économiques, priment et ne veulent surtout pas que les choses changent. Ils sont prêts à tout pour maintenir un système qui trouve le moyen de faire des profits en générant la destruction, puis en gérant les destructions elles-mêmes : c’est ce que l’on appelle le capitalisme vert. C’est pourquoi je suis persuadée que ces questions de l’effondrement, des changements climatiques ou de l’extinction de la biodiversité réactualisent la question de la lutte des classes et donc réimposent le fait d’avoir une vision extrêmement sociale de la situation.
Aujourd’hui, est-il devenu plus évident que les luttes environnementales sont intimement liées aux luttes sociales ?
C’est le fondement même de l’écosocialisme, qui part du postulat que les luttes sociales et les luttes environnementales sont totalement imbriquées. Cette écologie affirme son incompatibilité avec le système capitaliste. Il n’y a en effet pas besoin de fouiller très profondément pour se rendre compte que ce sont les mêmes rouages du système qui exploitent les ressources naturelles et les ressources humaines. Dans les deux cas, la réponse à apporter doit être systémique.
On vit aujourd’hui majoritairement dans des sociétés où la plupart des gens sont pauvres, et voient face à eux une accumulation indécente de superflu. C’est précisément ce superflu qu’il faut élaguer, car il n’est là que pour honorer une consommation ostentatoire, comme l’a écrit Thorstein Veblen, et faire augmenter les ventes et les profits des actionnaires.
Personnellement, je ne souhaite pas que l’on vive dans un monde où on ne satisferait plus que nos besoins primaires, d’où les désirs et les envies seraient gommés. Mais je crois qu’il existe énormément de choses dont on nous vante le besoin, pour lesquels on nous fabrique des envies, et qui en réalité ne comblent ni l’un ni l’autre, et qui finiront au fond d’un tiroir ou à la poubelle. Alors que tant de personnes manquent du nécessaire et que la biosphère se meurt, est-ce bien raisonnable de laisser faire ?
Cela pose également la question du partage. À partir du moment où les ressources qui nous permettent de vivre ne sont pas inépuisables, il faut réduire de manière considérable leur consommation à l’échelle globale. Mais c’est à ceux qui consomment le plus de réduire en priorité, et de manière drastique, leur consommation afin que ceux qui n’ont rien disposent au moins de quoi vivre décemment !
Vous citez dans votre livre l’anarchiste Charles-Auguste Bontemps qui dit vouloir replonger dans l’individualisme social donc un collectivisme des choses et un individualisme des personnes. C’est ce vers quoi nous devrions tendre selon vous ?
Une grande partie de mon livre est aussi dédié au fait d’essayer de replacer un trait d’union entre l’individuel et le collectif en politique. Caricaturalement, autant la droite a toujours eu tendance à tout miser sur l’individu sans prendre en compte les questions sociales, dans une vision libérale, autant à gauche on a tendance à énormément miser sur le collectif en oubliant parfois la place de l’individu. Je pense qu’il faut vraiment réconcilier les deux. J’essaie de le faire, par petites touches, dans mon livre, à travers des inspirations libertaires. Je suis moi-même à la fois très attachée à la question du commun, au sens large du terme, aux questions d’égalité, de partage et de répartition, d’absence d’appropriation par certains au détriment des autres. Les grandes valeurs qui sont celles de la gauche finalement. Je suis aussi très attachée à la singularité, à l’autonomie et à la liberté individuelle. Je sais à quel point l’appartenance à des groupes peut devenir sclérosante ou étouffante, voire relever parfois de l’embrigadement. Peut-être est-ce aussi parce que je me sens un peu en convalescence après ces dix années passées dans des collectifs très forts, très puissants, même s’ils sont extrêmement riches et intéressants. Je ne regrette pas cette phase de ma trajectoire professionnelle, mais je dois avouer être très heureuse de mon nouveau statut d’électron libre. Je peux assumer mes propres choix, tout en participant aux luttes collectives, de manière plus éclectique.
Comment arriver à désigner nos ennemis et ne plus culpabiliser son voisin qui roule avec une vieille diesel ?
Beaucoup de choses tournent autour des comportements individuels sans pointer du doigt la responsabilité des multinationales, des intérêts médiatiques, politiques, économiques. On ressasse toujours les mêmes questions, on s’acharne sur ceux qui ont déjà un mal fou à s’en sortir. C’est pourquoi j’écris dans mon livre que nos vrais ennemis sont ceux qui savent — parfois depuis très longtemps — et qui ont les leviers pour que les choses changent qu’ils n’actionnent pas afin de protéger leurs intérêts particuliers. Il ne faut donc pas se tromper de cible. Le voisin qui habite en zone rurale et qui doit prendre sa vieille voiture pour se rendre au travail n’a pas d’autre choix. Ça ne sert à rien de l’accabler. Commençons plutôt par taxer, par dénoncer et pointer les multinationales, celles et ceux qui ont les moyens de changer, celles et ceux qui détiennent les leviers. Commençons par rappeler que le rôle du politique c’est précisément de donner la possibilité de l’alternative et du choix. Ce qu’ils ne font pas.
Pourquoi pensez-vous que l’on ait mis autant de temps pour croire les scientifiques ?
Tout le monde n’a pas mis tant de temps que ça. Des rapports scientifiques ont circulé en interne dans certaines grandes entreprises dès les années 70. Ils ont été délibérément tus et mis dans un tiroir, ou utilisés pour mieux adapter les affaires à cette nouvelle donne, plutôt que d’essayer de la changer. Il existe des facteurs politiques, des intérêts en place très puissants relayés par des climato-sceptiques, plus ou moins fins, qui continuent à entretenir la confusion entre météo et réchauffement climatique. Des facteurs psychologiques aussi chez certaines personnes, sûrement. Mais surtout des intérêts, eux bien conscients, qui s’arrangent pour que le lien entre réchauffement climatique et organisation du système économique ne soit jamais établi. Dans le traitement de l’information, c’est d’ailleurs comme si toutes ces choses-là étaient indépendantes, totalement dissociées. Dès lors, il faut être muni d’une grande dose d’appétit, de curiosité, et de disponibilité tout simplement pour prendre le temps d’aller se renseigner, de lire, d’échanger, de débattre. Et même pour celles et ceux qui auraient les moyens d’acheter ailleurs, ce n’est pas si évident, par exemple, de faire spontanément le lien entre le bas prix d’un T-shirt H&M et son coût exorbitant pour la société, par les conditions dans lesquelles il a été produit et son impact sur l’environnement. Qui fait le lien avec les conditions de travail, la pollution due aux transports de marchandises, la production de tissus synthétiques fabriqués à base de dérivés du pétrole, lui-même une des principales sources d’émission de gaz à effet de serre ? Ces mécanismes ne sont pas souvent expliqués dans les médias, et le rapport entre ces marchandises à bas prix au coin de la rue et les rapports de scientifiques qui disent qu’à la fin du siècle nous serons à + 7 degrés n’est pas installé dans les esprits. Et puis +7 degrés, c’est de toute façon assez inimaginable…
Vous dites parfois éprouver de la colère envers « l’écologie intérieure », que voulez-vous dire par-là ?
Je parle d’une écologie à l’approche très auto-centrée qui se préoccupe beaucoup de la manière de s’alimenter, de se soigner, d’être en relation aux autres, etc., sans justement se poser ces questions de rapports de force, de domination et d’organisation de la production. C’est une vraie question politique. Il existe une écologie égoïste qui ne se préoccupe pas de la manière dont le reste du monde vit, ou survit. Naturellement je trouve très bien de se poser des questions sur soi-même, sur ses propres comportements, je considère même que c’est le minimum à vrai dire. Mais ça ne fait pas un programme politique. Aujourd’hui, personne n’a envie de s’intoxiquer en mangeant ou en se soignant. Mais beaucoup de gens aimeraient juste s’alimenter ou se soigner, déjà. Ne pas s’en préoccuper, c’est en rester au stade du petit bout de la lorgnette de l’écologie.
Vous écrivez « l’émancipation passe aussi par l’accès à l’éducation, la culture, qui en dehors des centres bourgeois ne seront jamais garantis par un opérateur privé ». Faites-vous référence à l’éducation populaire comme facteur d’influence et espace à occuper ?
En réalité cela va même au-delà des questions d’éducation populaire. J’ai vraiment de plus en plus l’impression qu’en tant que corps social, nous déléguons beaucoup trop de choses aux institutions, aux pouvoirs publics, des choses qui pourraient directement être prises en charge par les membres de la société eux-mêmes. C’est une belle occasion de se réapproprier la question de l’autogestion, des communs et de l’éducation populaire. Nous n’avons pas toujours besoin d’une institution pour apprendre ou faire, on peut aussi « s’apporter entre soi ». C’est vrai dans beaucoup de réseaux militants déjà, de l’anarchisme à l’accueil des migrants. Je crois que c’est vrai aussi pour l’art et la culture, du street-art au théâtre de l’opprimé. La question de l’autonomie est vraiment de plus en plus centrale, et elle peut s’appliquer dans beaucoup de registres différents. Il y a tant de choses à inventer ou tout simplement à développer, vers des formes d’action directe porteuses de leurs propres revendications, auto-réalisatrices. On cite souvent l’exemple de Rosa Parks qui, en s’asseyant à une place interdite aux Noirs, annule la loi par son propre geste. Bien sûr ce n’est pas aussi simple, mais c’est ce principe qui doit nous inspirer.
Enfin je ne dis pas qu’il ne faut plus du tout d’institutions ou de grands opéras, je ne veux pas faire de l’égalitarisme de base, et je ne pense pas que tout le monde soit capable d’écrire les Racines du ciel de Romain Gary ou les Cavaliers de Joseph Kessel, de jouer du violon ou de peindre la Joconde. Mais il existe d’autres formes culturelles plus populaires, plus autonomes, qui ont tellement été dévalorisées, méprisées ou invisibilisées… Ce sont toutes ces pratiques populaires autonomes qu’il convient de réhabiliter et de revaloriser.
Vous avez quitté il y a quelques mois le mouvement La France Insoumise, puis le Parti de Gauche. Pourquoi cette décision alors même que vous y étiez politiquement et humainement attachée ?
Il y a d’abord un facteur humain lié simplement au fait que pendant dix ans je me suis extrêmement investie dans des responsabilités nationales au sein du Parti de Gauche, dans une forme de militantisme très prenante à se présenter aux élections, à exercer un mandat etc. Une forme de lassitude donc mais aussi une envie d’aller à la découverte d’autres chemins de traverse.
Et puis, il y a aussi des raisons qui sont davantage politiques. D’abord, j’ai eu un certain nombre de désaccords par rapport à des positionnements pris par la France Insoumise. Notamment, cette idée selon laquelle le clivage gauche-droite serait dépassé et qu’il faudrait en venir à une forme de populisme ou de dégagisme. Cela me semble être une pente assez glissante et dangereuse en cette période actuelle où beaucoup de repères sont extrêmement brouillés. Je pense que ces repères de la gauche ne doivent pas être passés par pertes et profits. Bien au contraire, on a besoin aujourd’hui de réaffirmer ce que doit être la gauche. Il s’agissait donc d’un désaccord assez profond sur la stratégie politique.
Je trouve dommage également que tout le travail que nous avions fait au sein du Parti de Gauche autour du Manifeste pour l’écosocialisme ait été négligé, puisque ce terme d’écosocialisme et le contenu du manifeste ne sont plus aujourd’hui utilisé ou mis en valeur au sein du mouvement. C’est regrettable au vu du travail réalisé, y compris à travers la constitution d’un réseau écosocialiste européen, et d’un travail important de présentation auprès d’organisations sœurs dans de nombreux pays.
Et puis, il y a chez moi de manière plus générale un sentiment grandissant que la gravité, l’urgence de la situation en matière de climat et de biodiversité, l’accélération brutale de la dégradation et de la destruction du vivant, sont insuffisamment prises en compte. Ce n’est pas propre uniquement à la France insoumise ou au Parti de Gauche, mais il me semble que le temps des partis politiques, qui ont pour vocation de se présenter aux élections, qui ont une stratégie de conquête du pouvoir par les urnes, trouve aujourd’hui ses limites. Cette stratégie implique en effet beaucoup trop de temps et d’énergie passés à commenter l’actualité, à être présent sur les réseaux sociaux, à rechercher une visibilité médiatique, à repérer aussi parfois les créneaux les plus porteurs d’un point de vue électoral. Ce qui, me semble-t-il, opère un rétrécissement du débat politique et se fait au détriment d’actions menées sur le terrain. Pour ma part, s’est creusé un fossé trop important entre ces obligations liées au système électoral, au fonctionnement interne des partis, et le sentiment d’urgence à trouver d’autres modes d’actions politiques.
Vous parlez « des signifiants vides du populisme ». Qu’entendez-vous par-là ?
Je reprends cette expression de « signifiants vides du populisme » pour par exemple dire que lancer la campagne des européennes sur un référendum anti-Macron (même si c’est tout à fait légitime et que j’en comprends bien l’intention) est un peu indigent : cela ne fait pas un projet politique. Vous pouvez retrouver sur ce type de mot d’ordre des courants avec lesquels nous sommes en désaccord absolu. Aujourd’hui, être anti-Macron regroupe en réalité à peu près l’ensemble de la classe politique en France, à l’exception des macronistes précisément. Ça ne tire pas le débat vers le haut. Alors qu’honnêtement sur la question de l’Union Européenne, il y aurait beaucoup de choses à dire pour contrer le discours dominant où l’on continue à nous expliquer que l’Europe c’est la paix. Et puis, se référer au peuple est une forme d’abstraction, qui relève trop souvent du fantasme. J’aimerais qu’on m’explique qui est ce peuple… Aujourd’hui, il existe différentes classes précaires, différentes classes moyennes, des quartiers populaires et des paysans, autant de réalités quotidiennes différentes que décortiquent des travaux de sociologues très intéressants. Réduire tout cela au « peuple » et, encore plus, prétendre parler en son nom me parait un rien prétentieux. Pour toutes ces raisons, cette question du populisme n’est pas toujours utilisée me semble-t-il à bon escient. Il s’agit plus souvent d’un rétrécissement de la pensée que d’un renforcement politique.