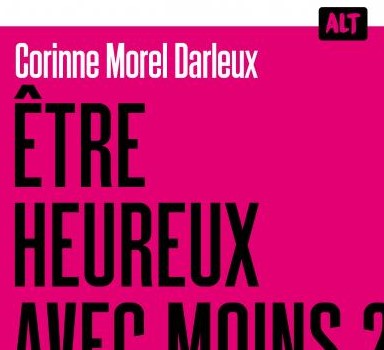Entretien réalisé avec Emilie Echaroux pour Usbek & Rika, juillet 2023.
Pour l’autrice, il y a un vrai plaisir à se délester du superflu – dont le numérique – « dans une société où la profusion de choix dans les supermarchés frise l’indécence ». Mais, est-ce à dire qu’il faut forcément avoir moins pour être heureux ? Cette ascèse doit-elle aussi s’appliquer à nos usages numériques, pour beaucoup jugés indispensables ? Corinne Morel Darleux nous répond.
Usbek & Rica : Le bonheur doit-il passer par le minimalisme ?
On ne peut simplement affirmer qu’on peut être heureux avec moins, à une époque où tant de personnes manquent du nécessaire. Il y aurait une forme d’indécence à asséner une leçon de morale si éloignée de la réalité matérielle d’une grande partie de la population en France et dans le monde. Il s’agit plutôt de se poser les bonnes questions et de cibler les personnes qui vivent suffisamment confortablement pour pouvoir se passer d’un certain nombre de choses superflues, dont la production épuise les ressources et flingue le climat, sans pour autant procurer beaucoup de bonheur – et à un coût social et environnemental exorbitant : cela en vaut-il la peine ?
La société nous pousse à adopter des comportements d’accumulation matérielle, de recherche de carrière professionnelle et de richesse monétaire qui, pour toute une partie de la population, se confondent avec une quête de bien-être. Les normes et constructions sociales avec lesquelles on a grandi nous soufflent en permanence qu’il faut avoir une Rolex à 50 ans pour avoir réussi sa vie. De plus en plus de personnes, engluées dans cette course effrénée de réussite matérielle, perçoivent pourtant qu’elle ne les rend pas plus heureux et qu’elle les coupe d’un rapport sensible au monde, les prive de temps et réduit leur disponibilité cognitive, émotionnelle et affective.
À quoi se résume le bonheur, selon vous ?
Une des faits les plus marquants et les plus nocifs de notre époque, me semble-t-il, est le manque de temps. La fameuse économie de l’attention nous cause beaucoup de tort, à la fois individuellement et collectivement. Avoir le temps devient un luxe, et on est d’autant plus plongé dans un sentiment d’urgence permanente qu’on est précaire. Ce temps réapproprié, c’est aussi celui de l’émancipation, et c’est une des conditions du bonheur.
La sobriété, la décroissance, sont aussi une manière de retrouver du temps. L’autonomie politique et matérielle permet d’acquérir des savoirs manuels et artisanaux, de se rendre compte qu’on est interdépendants, de reprendre de la puissance d’agir et de trouver d’autres manières de faire ensemble. Elle agit à rebours de la compétition, du statut par l’argent, des signes ostentatoires de richesse, qui nous dressent les uns contre les autres au profit des dominants qui en tirent leurs profits et leur emprise. Les processus de prédation, que ce soit sur les écosystèmes, les femmes ou les précaires, toutes celles et ceux qu’on traite de « sauvages », sont à la base du système capitaliste qui les engendre et s’en nourrit.
La sobriété est donc devenue un facteur indispensable au bonheur ?
Effectivement, je crois que la sobriété est un point crucial en matière de bonheur. D’abord, très prosaïquement, parce qu’elle est la condition sine qua non pour conserver un monde habitable. La question du bonheur ne se pose pas dans un monde privé d’air sain, d’eau potable et des moyens de se nourrir. Mais même sans cette urgence, elle resterait un horizon désirable.
Ce n’est malheureusement pas une possibilité qui s’offre à tout le monde. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas faire reposer la transformation de nos modes de vie uniquement sur des choix individuels. On a aussi besoin que ce soit le résultat de choix collectifs et de politiques publiques, dont je commence hélas à croire qu’elles ne viendront jamais.
Mais ne faudrait-il pas ne exiger cette sobriété avant tout de la part des plus riches, qui sont les plus gros pollueurs ?
D’un point de vue politique, il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que ce sont les plus riches, ceux qui font tourner ce système destructeur et qui en bénéficient, qui doivent être recadrés par la loi, taxés, fournir les plus gros efforts et changer de modes de vie. Par contre, d’un point de vue éthique, cette question concerne tout le monde. Elle ne peut ni exclure les classes moyennes, ni les plus précaires, précisément parce qu’on leur a trop longtemps dénié le droit à la dignité et la possibilité de faire des choix individuels. Évidemment, ces choix ne peuvent pas être les mêmes pour tous. Mais, à ce niveau d’urgence, il n’y a plus de gestes dérisoires. Et tout ce qui permet de restaurer des marges de manœuvre et de la dignité compte en soi.
Par ailleurs, ce serait un peu facile pour les classes moyennes supérieures de se décharger de toute responsabilité sur un gouvernement scélérat. Eux sont coupables, car ils ont les leviers et piétinent l’intérêt général, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Leurs fautes ne doivent pas nous exonérer du souci d’une éthique de la sobriété et de choix éclairés.
Ne faudrait-il pas aussi tendre vers un rapport plus sobre au numérique ?
Absolument. Le constat est très clair : on commence à parler de pénuries de métaux et de matières premières, d’eau et d’énergie pour les extraire, nécessaires à l’escalade numérique. On fait également face à des risques accrus de rupture d’approvisionnement, notamment en termes d’électricité. Les menaces de pannes deviennent critiques dans tout un tas de pays, notamment l’été quand la climatisation fonctionne à bloc face à la multiplication des canicules.
Théoriquement, si demain on décidait de se passer de tous les usages technologiques qui ne relèvent pas d’infrastructures vitales, on aurait encore la capacité de limiter les dégâts. Mais cela reste théorique. Car à force de se délester de certaines tâches et de les confier à des algorithmes et des applications, on s’est rendu dépendant d’une source extrêmement dangereuse, car énergivore et opaque. Personnellement, je suis très inquiète de la perte de savoirs que l’extension du numérique a engendré. Cette dépendance rend insidieusement indispensables les usages évitables, inutiles et toxiques. C’est une menace considérable.
Devra-t-on un jour dire adieu à tous nos usages numériques ?
Il va falloir apprendre à se passer du numérique. On devrait déjà être en train d’anticiper le moment où on n’aura plus les ressources nécessaires. Et au vu des dommages que cela cause déjà, on aurait du se poser ces questions il y a un bout de temps déjà. Il faut d’urgence prioriser les usages qui nous permettent de bien vivre.
Il nous reste environ trente ans de numérique devant nous, selon le cabinet Green IT. Or même dans les milieux technocritiques, on s’inquiète – à juste titre – de l’essor du numérique mais très peu de sa fin programmée. C’est pourtant un risque majeur, et nous ne sommes pas du tout prêts. Nos imaginaires futuristes reposent toujours sur une extension sans fin de la robotique, d’exosquelettes et d’intelligence artificielle. On devrait se poser sérieusement la question de ce qui va se passer quand les écrans s’éteindront et commencer à anticiper le monde d’après le numérique.
Ne devrait-on pas aussi dire adieu à la ruée vers la productivité ?
Les seuils de contre-productivité établis par Ivan Illich, professeur à l’université d’État de Pennsylvanie, montrent que si certaines innovations technologiques peuvent apporter, à un moment donné, un mieux-être, elles ont par la suite des effets contre-productifs. Il utilise l’exemple de la voiture qui, au lieu de nous faire gagner en mobilité et en confort de vie, a pris une place vorace et toxique dans la société. Alors qu’elle devait nous faire gagner du temps, entre le temps passé à travailler pour gagner de quoi payer les assurances et le carburant, les heures passées dans les embouteillages ou à chercher une place pour se garer en ville, au final Illich a calculé qu’on n’allait pas plus vite en voiture qu’un cycliste.
Prenons la fameuse « dématérialisation », censée optimiser les démarches en les passant en ligne. C’est une calamité. On fait face à des erreurs 404 en rafale. Les personnes âgées se retrouvent seules face à leur écran. On ne peut plus parler à un être humain pour se faire expliquer les points obscurs. On perd des heures à essayer de comprendre et in fine des technologies qui étaient censées nous simplifier la vie nous la rendent juste plus compliquée.
Pensez-vous que nos standards de bonheur vont changer et que, demain, ce ne seront plus Elon Musk ou Jeff Bezos qu’on admirera mais des personnes au mode de vie sobre ?
C’est un des gros enjeux de la bataille culturelle que de changer le camp du cool et du stylé. On aura fait un grand pas quand se balader en quad ou organiser un rallye automobile dans un parc naturel sera perçu comme honteux et malaisant. Il y a tout un référentiel et des codes culturels à déconstruire. Mais c’est un processus long et compliqué, il est difficile de se défaire des normes qu’on nous a inculquées.
Nos référents du luxe doivent aussi changer. On doit pouvoir déboulonner l’imaginaire du yacht et des diamants, trouver du calme et de la volupté ailleurs que dans un jet privé ou une villa à l’autre bout du monde avec chauffeur et piscine chauffée. Si l’on considère que le luxe aujourd’hui est d’avoir du temps, du calme et un espace à soi, alors une cabane remplie de belles choses simples peut devenir une réelle source de plaisir et de bonheur. Ce n’est qu’un exemple, chacune et chacun aura sa propre version de ce qui le fait rêver, mais on doit retrouver une notion du luxe qui ne passe pas par des logiques de domination et de prédation.