Alors que je prépare ma rencontre avec Swann Arlaud autour du droit à la beauté et sur la manière de questionner l’utilitarisme des récits, je relis cet entretien mené avec Les cahiers de la photographie pour le numéro intitulé Beauté vivante et paru en juillet, qui me semble tomber à point nommé. Je ne l’avais pas encore partagé, le voici…
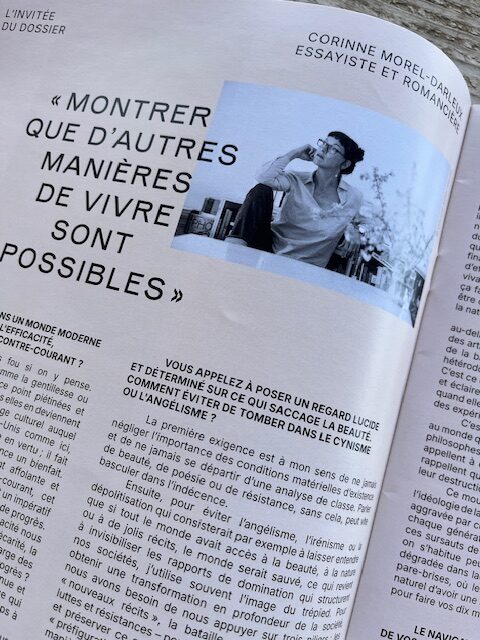 Choisir la beauté dans un monde moderne qui privilégie la vitesse et l’efficacité, n’est-ce pas devoir vivre à contre-courant ?
Choisir la beauté dans un monde moderne qui privilégie la vitesse et l’efficacité, n’est-ce pas devoir vivre à contre-courant ?
Absolument. C’est d’ailleurs fou si on y pense. Comment l’attention à la beauté, comme la gentillesse ou la décence, ont-elle pu devenir à ce point piétinées et dénigrées que d’éthiques et inoffensives, elles en deviennent politiques et subversives ? Le dévissage culturel auquel nous assistons actuellement, aux États-Unis comme ici, mise sur le ressentiment et érige la haine en vertu ; il fait de la médiocrité une qualité et de l’ignorance un bienfait. Cette inversion orwellienne est proprement affolante et vertigineuse. Dès lors, rejoindre le contre-courant, cet espace calme et à l’écart près des rives, devient un impératif pour s’extraire du flux boueux de ce torrent dévastateur qualifié de progrès.
Car enfin, le culte de la vitesse et de l’efficacité nous ont-ils conduit à davantage de bien vivre ? La précarité, la santé mentale, la faim, l’éducation et la prise en charge des soins : tous les indicateurs régressent. Où est le progrès ? Rappelons, avec Paul Virilio, que l’accélération continue et exponentielle est une tyrannie, et que la vitesse est ce qui détermine la gravité d’un accident. Que gagner du temps à tout prix, c’est in fine perdre la vie.
Je veux soutenir que des espaces considérés aujourd’hui comme « non essentiels » ou « improductifs », au nom de l’efficacité capitaliste – qui consiste à rémunérer le capital investi le plus possible, le plus vite possible – : l’art, les paysages, le temps libre, la rêverie, l’amour, la poésie, l’émerveillement, l’otium, tout ce qui est gratuit, sont essentiellement ce qui fait, pour reprendre la formule de Françoise Héritier, le sel de la vie.
Vous appelez à poser un regard lucide et déterminé sur ce qui est en train de saccager la beauté. Comment éviter de tomber dans le cynisme ou l’angélisme ?
La première exigence est à mon sens de ne jamais négliger l’importance des conditions matérielles d’existence et de ne jamais se départir d’une analyse de classe. Parler de beauté, de poésie ou de résistance, sans cela, peut vite basculer dans l’indécence.
Ensuite, pour éviter l’angélisme, l’irénisme ou la dépolitisation qui consisterait par exemple à laisser entendre que si tout le monde avait accès à la beauté, à la nature ou à de jolis récits, le monde serait sauvé, ce qui revient à invisibiliser les rapports de domination qui structurent nos sociétés, j’utilise souvent l’image du trépied : pour obtenir une transformation en profondeur de la société, nous avons besoin de nous appuyer sur trois piliers : les « nouveaux récits » et la bataille culturelle, c’est certain, mais aussi les luttes et résistances – pour s’interposer face à la destruction et préserver ce qui peut encore l’être – et les alternatives « préfiguratives », pour faire la démonstration, ici et maintenant, que d’autres manières de vivre sont possibles.
Enfin, pour éviter le cynisme – qui relève aujourd’hui selon moi d’une faute morale -, il importe de toujours associer un discours de lucidité avec un impératif éthique qui relève non de l’espoir ou de l’optimisme, mais de ce que je nomme « dignité du présent » : face au sentiment de défaites futures de plus en plus inexorables, si on veut éviter de rester sidéré ou de se décourager, il faut se souvenir que quand on s’engage dans une cause, ce n’est pas fondamentalement pour gagner, mais avant tout parce que la cause nous semble juste à mener – et que même quand tout semble flingué, il reste toujours un pessimisme à organiser, des lueurs à préserver, des gestes de solidarité, des hectares de terres non bétonnées, des espèces d’invertébrés et des dixièmes de degré à sauver.
Sauver la beauté qui nous entoure demande de gagner la bataille culturelle pour l’amour du monde vivant. Vous pouvez préciser ?
Je l’ai souvent dit et écrit, on ne défend bien que ce qu’on a appris à aimer, et l’effacement du beau est un appel scélérat au renoncement. Car qu’est-ce qui motive à préserver le fond des océans si vous n’avez jamais vu à quoi ça ressemblait, à lutter contre la fonte des glaciers, si vous n’avez jamais eu la chance d’aller en montagne ? A mobiliser du temps et de l’énergie pour une solidarité et une entraide que vous n’avez jamais éprouvées ? A payer vos impôts pour financer des services publics qui maltraitent par manque d’effectifs et de moyens ? Comment défendre le monde vivant, déboulonner le colonialisme et le patriarcat, quand ça fait des décennies, que dis-je, des siècles, qu’on vous explique que le sauvage doit être civilisé, que la femme a été créée pour enfanter, et que la nature est là pour être exploitée ?
Nous devons changer de paradigme. Or, pour modifier nos représentations, nous avons besoin, au-delà des concepts, d’être affectés. Et à ce titre, les travaux des artistes, des photographes ou des romancières relèvent de la bataille culturelle quand ils contribuent à une vision hétérodoxe, non-utilitariste, décalée et inusitée du monde. C’est ce que permet la création quand elle décadre le regard et éclaire les interstices, là où la lumière ne pénètre jamais, quand elle rend sensible, donne à voir, à ressentir, à éprouver des expériences inaccessibles dans la vie quotidienne.
C’est dans ce même bouleversement de notre rapport au monde que s’engagent des scientifiques, anthropologues, philosophes, climatologues, naturalistes, quand ils et elles appellent à cesser de dissocier l’être humain de la nature, quand ils et elles rappellent ce qui devrait être une évidence tant cela relève du bon sens, à savoir que nous faisons partie des écosystèmes et que leur destruction sera aussi la nôtre.
Ce mouvement me semble fondamental pour contrer l’idéologie de la croissance à tout prix, d’autant que celle-ci est aggravée par ce qu’on appelle l’amnésie environnementale : chaque génération se référant à ce qu’elle connaît, sans ces sursauts de rappel et d’alerte de l’art et de la science, on s’habitue peu à peu à trouver normale une situation dégradée dans laquelle les insectes ne constellent plus les pare-brises, où les oiseaux se font rares, et où il devient naturel d’avoir une application qui vous dit quand vous lever pour faire vos dix mille pas de la journée.
Le navigateur Bernard Moitessier, l’une de vos références, compare la Terre à un beau voilier courant à la catastrophe avec un capitaine qui attend un miracle…
… Mais aussi avec à bord des « va-nu-pieds » qui « ne portent pas de gants, pour mieux sentir la vie des cordages et des voiles », qui « parlent peu, observent le temps, lisent dans les étoiles et dans le vol des mouettes, reconnaissent les signes que leur font les dauphins » et savent que le voilier court à la catastrophe, mais n’ont pas accès à la barre et sont pendus quand ils tentent de modifier le cap.
Bernard Moitessier le souligne : « un miracle ne peut naître que si les hommes le créent eux-mêmes, en y mettant leur propre substance ». Personnellement, je ne crois ni aux miracles, ni aux capitaines. Mais ces va-nu-pieds là, je serai toujours de leur côté.
